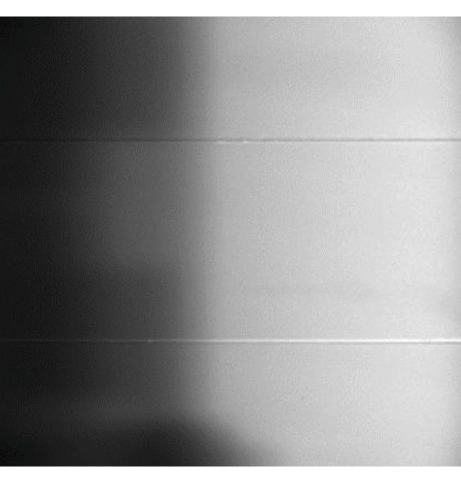Installation multiaxe
Dès le début de la conception de l’installation Epure, la question s’est posée de savoir quel serait l’effet du fonctionnement d’un axe sur les détecteurs des autres axes. Cette question est restée longtemps sans réponse claire, en raison de la limitation des moyens de simulation de l’époque et du manque de données expérimentales.
À la fin de la construction de la phase 1 (utilisant un seul axe radiographique), des campagnes expérimentales ont été menées pour apporter des éléments de réponse. En plaçant des détecteurs dans la salle d’expérience, mais en dehors du faisceau X, on a caractérisé le rayonnement appelé diffusé croisé. Il s’agit du rayonnement provenant de la déviation (ou encore, diffusion) du faisceau radiographique sur les équipements de la salle d’expérience, vers les détecteurs des autres axes radiographiques. La figure 1 illustre les chemins empruntés par le rayonnement diffusé dans le cas du fonctionnement de l’axe 1.
Un principe général est que tous les éléments placés sur le trajet du faisceau sont susceptibles de diffuser du rayonnement dans le reste de la salle d’expérience. C’est principalement le cas pour la porte coupe-feu et les fenêtres d’entrées du DCo (dispositif de confinement). Une dernière contribution s’ajoute, venant directement de la cible de conversion. En effet, le rayonnement X produit étant très intense et peu directionnel, il parvient à passer à travers les murs en béton entourant la partie terminale de l’accélérateur du premier axe. Les campagnes expérimentales menées ont permis de montrer que le signal capté par le détecteur de l’axe 2 est dix fois supérieur au niveau acceptable, avec un fort gradient latéral, comme le montre la figure 2. Or, pour garantir la bonne qualité de la radiographie, deux conditions sont nécessaires : une certaine limite ne doit pas être dépassée et le rayonnement diffusé doit avoir une empreinte homogène sur le détecteur. Par rapport à la mesure de la figure 2, un facteur 10 doit donc être à gagner, tout en réduisant au mieux le gradient du signal. Des travaux ont ainsi été lancés pour concevoir des protections, dites anti-diffusés, permettant d’atténuer ces rayonnements jusqu’à un niveau acceptable. Le passage de l’installation en phase 2 et la modification du hall d’expérience pour l’accueil des deux axes de radiographie supplémentaires a offert l’opportunité de les installer.
Une contrainte importante est à prendre en compte lors de la conception des protections anti-diffusés, il s’agit du risque sismologique. Lors d’un séisme, en aucun cas le DCo ne doit taper contre un mur ou les équipements qui l’entourent. Cela veut dire qu’il y a une zone d’exclusion autour du DCo, où on ne pourra pas positionner de protection anti-diffusés. Dès lors, la solution la plus évidente et la plus efficace, consistant à relier par un tube l’entrée du DCo à la sortie des machines radiographiques (voir figure 3), est exclue.
Les protections anti-diffusés ajoutées à l’installation sont visibles sur la figure 4. Pour atténuer le rayonnement allant de la source aux détecteurs des autres axes en passant à travers les murs de béton, ceux-ci ont été recouverts de tuiles de tungstène (épaisseur 4 cm) et de plaques d’acier (épaisseur 12 cm). Cette protection supplémentaire est très efficace et remplit bien son rôle. Pour se prémunir du rayonnement diffusé restant, provenant de la porte coupe-feu et du DCo, des barres en tungstène ont été placées de part et d’autre de la porte coupe-feu, des anneaux en acier ont été disposés sur le DCo et des plaques en acier de chaque côté des détecteurs. Ces dispositifs permettent ainsi de réduire les lignes de fuite à un niveau acceptable tout en garantissant l’homogénéité sur l’image.
A. Friou CEA - DAM, centre DAM Île-de-France
la radiographie éclair
figure 2
 Image mesurée par le détecteur de l’axe 2 lors d’un flash sur l’axe 1. L’ombre de certains équipements apparaît sur l’image (zone plus sombre à gauche), ce qui rend une radiographie inexploitable.
Image mesurée par le détecteur de l’axe 2 lors d’un flash sur l’axe 1. L’ombre de certains équipements apparaît sur l’image (zone plus sombre à gauche), ce qui rend une radiographie inexploitable.
figure 3
 Vue schématique d’Epure phase 1. Sans contrainte sismologique, la solution la plus évidente pour confiner le rayonnement diffusé serait de relier l’axe 1 (Airix) au DCo par un tube en acier. Cependant, les risques sismologiques font que cette solution est inapplicable.
Vue schématique d’Epure phase 1. Sans contrainte sismologique, la solution la plus évidente pour confiner le rayonnement diffusé serait de relier l’axe 1 (Airix) au DCo par un tube en acier. Cependant, les risques sismologiques font que cette solution est inapplicable.
figure 4
 Vue schématique d’Epure phase 2 avec les dispositifs anti-diffusés : plaques en acier et en tungstène sur les murs, anneaux en acier disposés sur le DCo et plaques en acier de chaque côté des détecteurs.
Vue schématique d’Epure phase 2 avec les dispositifs anti-diffusés : plaques en acier et en tungstène sur les murs, anneaux en acier disposés sur le DCo et plaques en acier de chaque côté des détecteurs.
figure 1
 Vue schématique (de haut) de l’installation Epure phase 1. Le faisceau X est en gris clair, le rayonnement diffusé est représenté par les flèches rouges.
Vue schématique (de haut) de l’installation Epure phase 1. Le faisceau X est en gris clair, le rayonnement diffusé est représenté par les flèches rouges.

 Article précédent
Article précédent